Par Marc-André Lévesque
L’histoire des personnes qui sont nées au village et, tout en restant ailleurs, ont gardé des liens avec notre communauté. Il s’agit de personnalités dont la notoriété a dépassé nos frontières et celles de notre Québec pour se faire connaître dans des domaines particuliers. La première de ces personnes est Benoit Lévesque, professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal qui, par ses recherches en sociologie, s’est fait connaître dans plusieurs pays où il a donné des conférences, entre autres sur le thème de l’économie sociale. Ce qui suit est issu d’un entretien que j’ai eu avec lui.
Benoit Lévesque est né à St-Ulric en 1939, la maison de ses parents, Rosaire Lévesque et Apauline Bélanger, née à Baie-des-Sables, était située sur le rang 3 de Tartigou.
Voici ses réponses à mes questions, présentées sur trois éditions du journal :
Tu as vécu 18 ans dans ce qu’on appelle maintenant La Matanie, dont 13 ans à Saint-Ulric, sans être trop nostalgique qu’en retiens-tu ?
Si je ferme les yeux, de nombreuses images surgissent comme des photos :
– Une première image qui date de 1945, j’ai 6 ans. Je vis dans une famille élargie qui comprend mon père et ma mère, mais aussi mon grand-père et ma grand-mère et ma tante (la sœur de mon père). Tout le monde est actif.
– Une deuxième image : j’ai sept ans, au village pour l’année scolaire chez ma grand-mère et ma tante qui viennent de s’y installer. Je suis inscrit à l’école primaire que dirigent les Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire.
– Une troisième image : j’ai huit ans, maintenant à l’école du rang 2 de Tartigou, une école multiniveaux (1 ère à 7e année). Sur l’heure du midi, la maîtresse d’école entre dans sa cuisine pour son diner. Elle ouvre la radio, les « Joyeux Troubadours ». C’est comme à la maison.
– Des images de l’hiver, début des années 1950 :
o C’est l’hiver, mon père, Rosaire, sort de la forêt avec un cheval, des billots et de la pulpe (la pitoune) qui ont été coupés par un homme engagé, Wilfrid Bernier.
o C’est Noël, ma mère Apauline introduit l’arbre de Noël dans la maison pour la première fois, ma grand-mère ne fêtait que le jour de l’an.
– Des images de l’été du début des années 1950 :
o Le temps des foins, je me retrouve dans la grange sur le fenil, à déplacer le foin et à le fouler. C’est presque irrespirable. Mais je ne me plains pas.
o Le temps des vacances, la visite pendant une semaine de la famille de Célina et de Paul, le frère de mon père, avec leurs enfants, mes cousins et cousines. C’est la grande fête de l’été.
o Une visite exceptionnelle, celle de parents provenant des États-Unis qui parlent français avec des mots d’anglais. Des étrangers sympathiques qui sont des parents.
– Enfin, le dimanche, dans l’église pleine à craquer, tout le monde en habits du dimanche. On apprend les noms des familles présentes. Les cloches sonnent, c’est joyeux.
Ces images sont celles d’un monde rural, où tous travaillent, souvent péniblement, mais pas nécessairement avec rémunération. Dans cet environnement, où la religion domine, la solidarité et le collectif donnent un sens à la vie, mais plusieurs envisagent de quitter la région pour assurer leur avenir.
À l’époque où tu as vécu à St-Ulric, le village semblait être dans une phase d’autosuffisance ou presque, qu’est-il arrivé pour que ça change et si on se fie à la période actuelle de crise climatique à quoi faut-il s’attendre ?
En 1946-1947, le village a été pour moi un choc en raison de son dynamisme, à commencer par la circulation des personnes et des biens : des gens de la campagne qui viennent au village et des gens de l’extérieur, fournisseurs, vendeurs, etc. La station du chemin de fer et le quai représentent deux portes ouvertes sur l’extérieur.
Le village était alors un milieu de vie et un milieu de travail.
– D’abord, un centre de services (services religieux, un curé et un vicaire, une douzaine de commerces, un barbier, quatre garages, une banque et une caisse populaire, une coopérative agricole, etc.).
– Mais aussi un centre de production artisanale : couturière, ferblantier, cordonnier, forgeron, orfèvre.
Saint-Ulric (village et paroisse) constituait la plus importante collectivité de La Matanie, après Matane (voir les photos des villages le long de la rivière de Matane).
Tout cela est pratiquement disparu. Que s’est-il passé ?
– D’une part, la production industrielle des casseroles par une machine était moins coûteuse que celle faite à la main par le ferblantier Anctil, à Saint-Ulric. De même, avec l’industrialisation de l’agriculture, les tracteurs ont remplacé les chevaux ; les forgerons ont perdu leurs clients. Pour augmenter les revenus nécessaires à ces achats, les fermes devaient grossir, réduisant ainsi leur nombre.
– D’autre part, la généralisation progressive de l’automobile a permis de réduire la distance, ce qui a permis d’aller faire ses achats à Matane ou à Rimouski.
Saint-Ulric est passé d’une collectivité relativement autosuffisante à une collectivité de plus en plus intégrée à la production industrielle et capitaliste pour les biens achetés et en même temps dépouillée des services de proximité qui seront centralisés dans les villes petites et moyennes. À la fin, un mode de vie est disparu et un autre venant de l’extérieur s’est imposé.
Il me semble t’avoir entendu dire que sans le soutien financier de personnes aisées financièrement, plusieurs jeunes du village n’auraient peut-être pas pu avoir accès à une formation adéquate, peux-tu donner une explication ?
À l’époque, pour faire des études secondaires et surtout des études classiques, il fallait aller au Séminaire de Rimouski, voire à Québec, Montréal ou ailleurs. J’ai été surpris du nombre de jeunes qui quittaient alors Saint-Ulric. Mais, il s’agissait d’exceptions le plus souvent identifiées par le curé lors de la visite des écoles ou par les recruteurs de congrégations religieuses à la recherche d’étudiant.
Pour une famille modeste, le fait de payer les voyages, l’habillement et certains autres besoins représentaient déjà une dépense importante. En revanche, le coût des études et du pensionnat (logement et nourriture) était trop élevé pour la plupart des familles. Dans ce cas, le collège faisait appel à un bienfaiteur pour couvrir ces frais. Ce fut mon cas. En contrepartie, je savais que je devais être un premier de classe. On n’a pas eu besoin de me le rappeler.
Au début des années 1950, les réformes réalisées dans l’éducation à partir de 1960 étaient presque impensables. Aujourd’hui, ce qui apparaît étrange, c’est plutôt ce que j’ai vécu à cette époque.








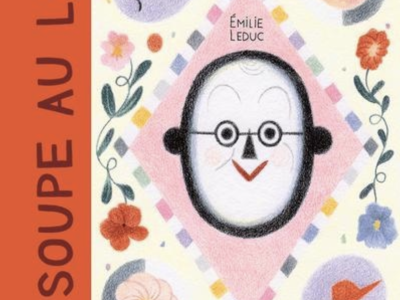







Commentaires